Fécondation in vitro
La FIV englobe un ensemble de traitements dans le but de féconder en laboratoire les cellules reproductrices de la femme (ovules) par les cellules reproductrices de l’homme (spermatozoïdes).
Le recours à la FIV
La fécondation in vitro se pratique notamment dans certains cas d’infertilité :
-
lorsque les trompes de Fallope de la femme sont obstruées ou inexistantes.
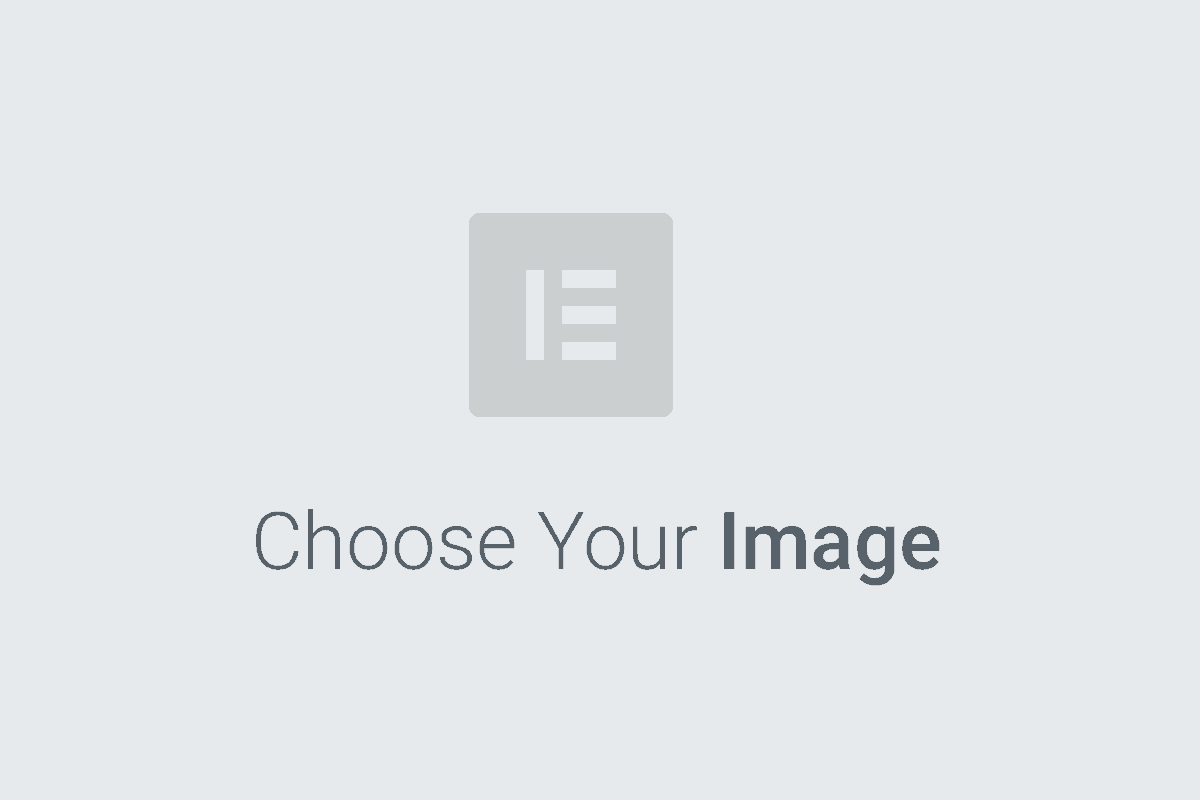
-
lors d’infertilité masculine sévère.
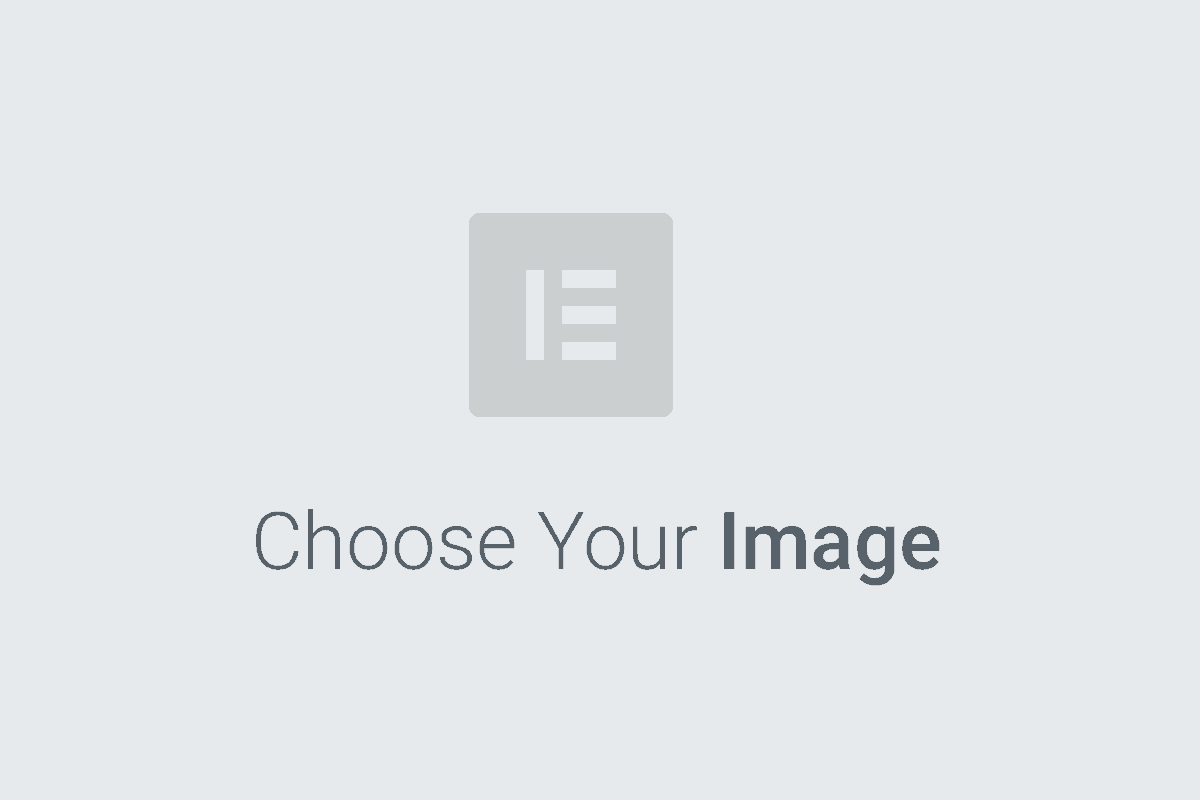
-
lors d'endométriose où les adhérences ou le tissu endométrial viennent freiner la production des ovaires.
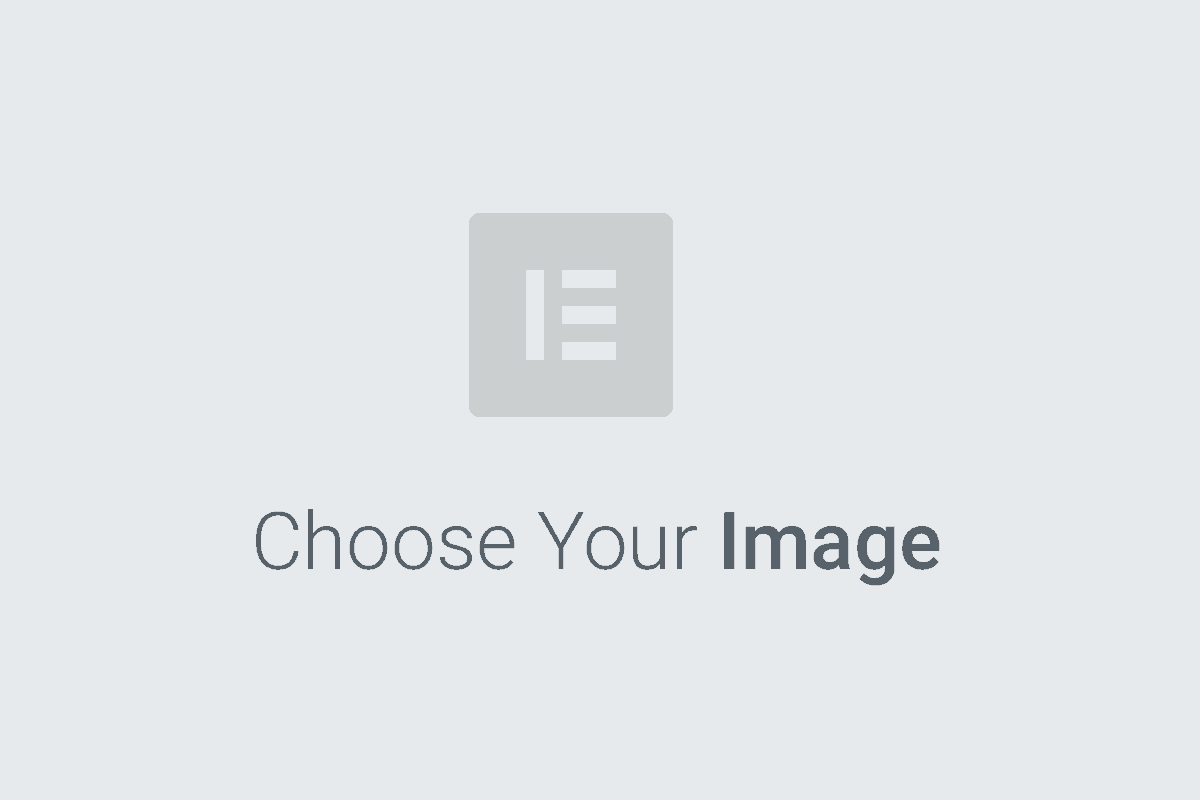
-
en cas d’infertilité dont la cause n’a pu être décelée.
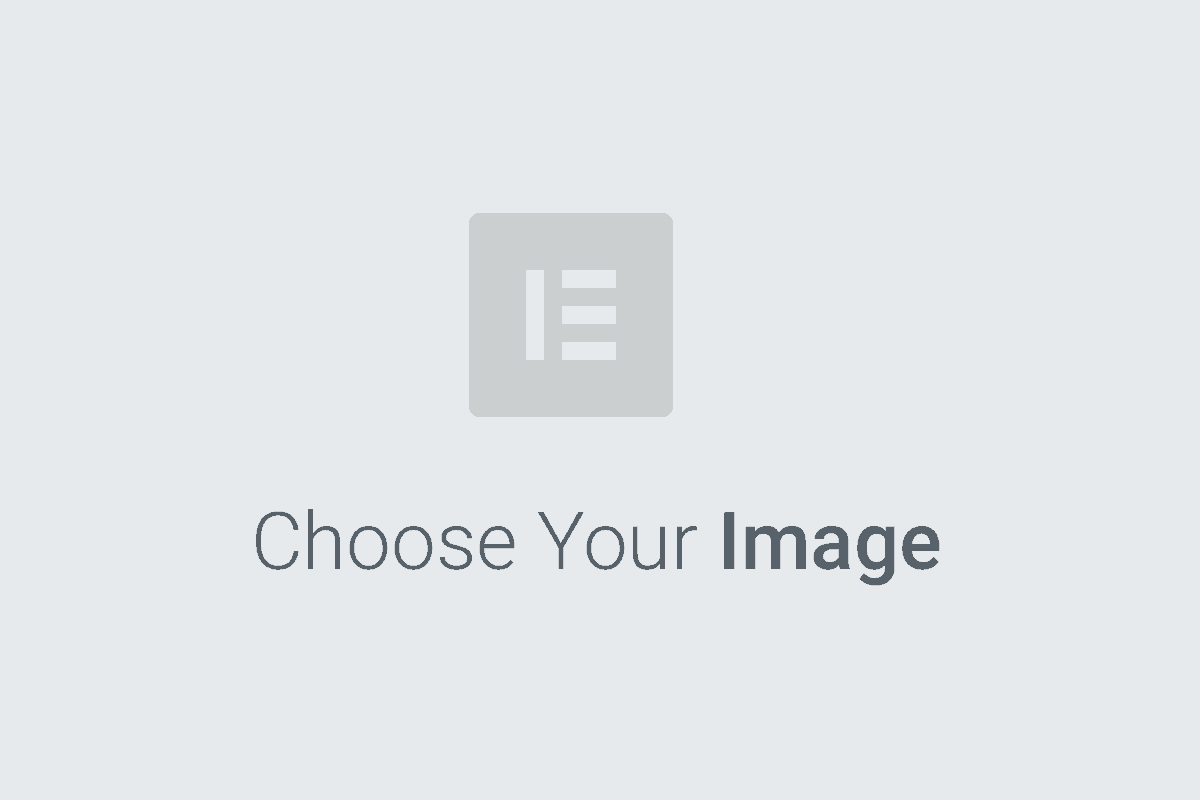

Les techniques associées à la FIV telles que méthodes de fertilisation, de culture, de testing des embryons et de cryo-conservation influencent ce taux.
ART Fertilité vous accompagne dans vos démarches
Attention : le nombre de traitements effectués par année, le type de traitement (FIV naturelle, ICSI, avec dosages forts ou doux), la qualité du laboratoire et la formation des médecins sont des éléments pouvant faire la différence dans le taux de réussite, d’où la nécessité d’être bien informé et accompagné.
Le tarif de la FIV oscille entre 2 500 € et 15 000 € selon le pays, la clinique et les options choisies (ICSI, DPI…). Par exemple, en Suisse, le tarif de la FIV est d’environ CHF 12’000 et celle-ci n’est pas remboursée par l’assurance maladie.
Le processus de la fécondation in vitro (FIV)
Le processus de FIV (fécondation in vitro) est adapté selon le cas :
-
soit de façon classique sur cycle substitué : vos hormones sont remplacées par les traitements,
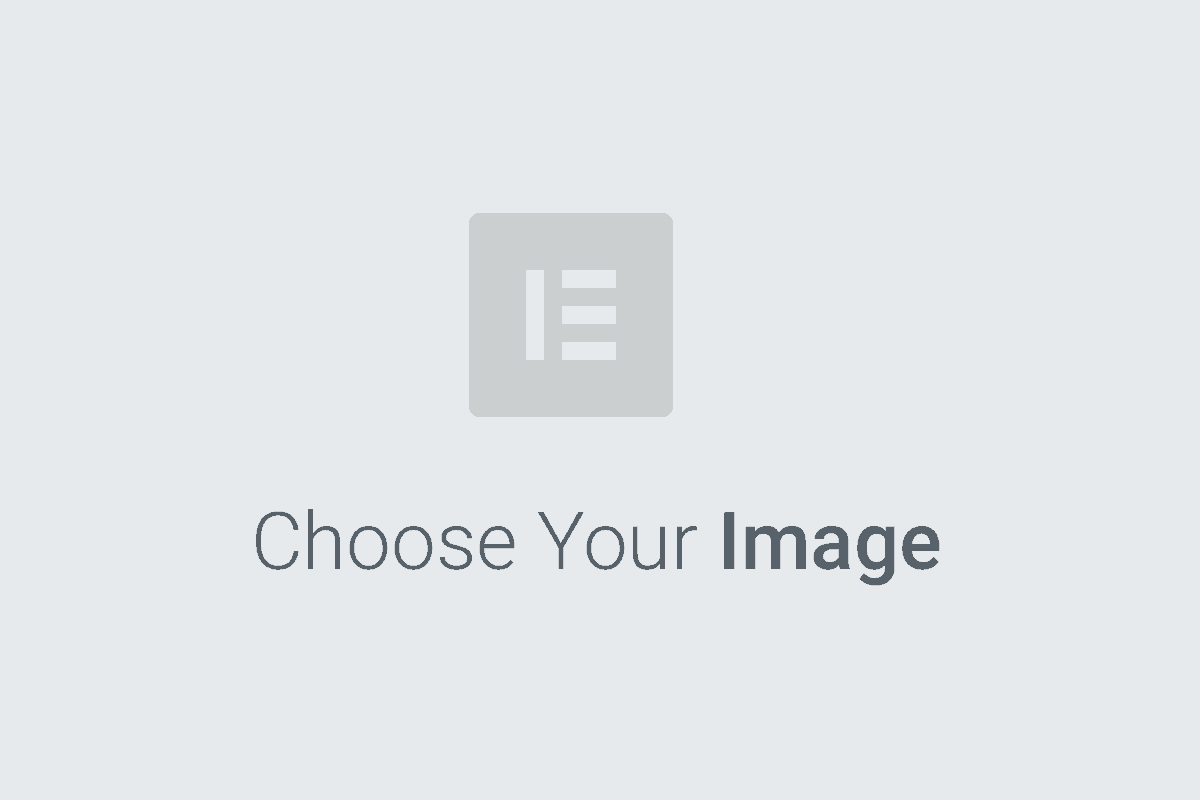
-
soit sur cycle stimulé : vous bénéficiez de vos propres hormones boostées par les traitements,
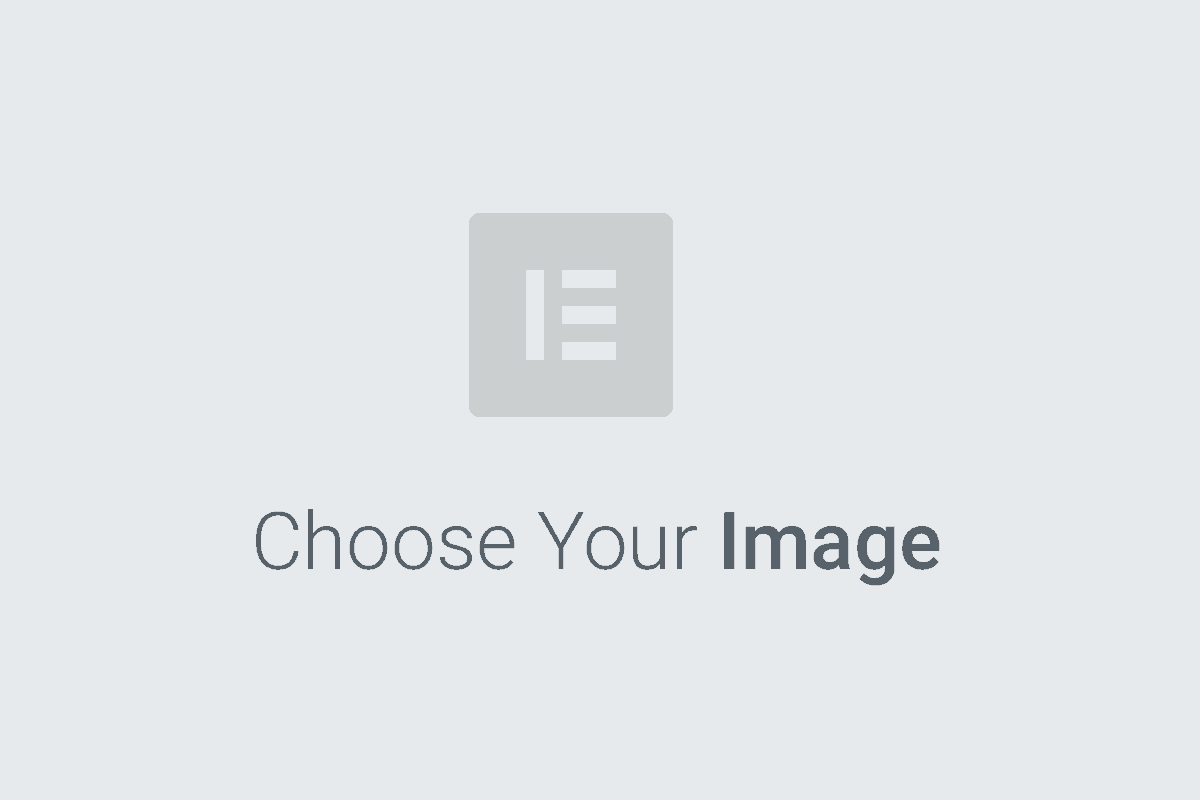
-
soit sur cycle naturel.
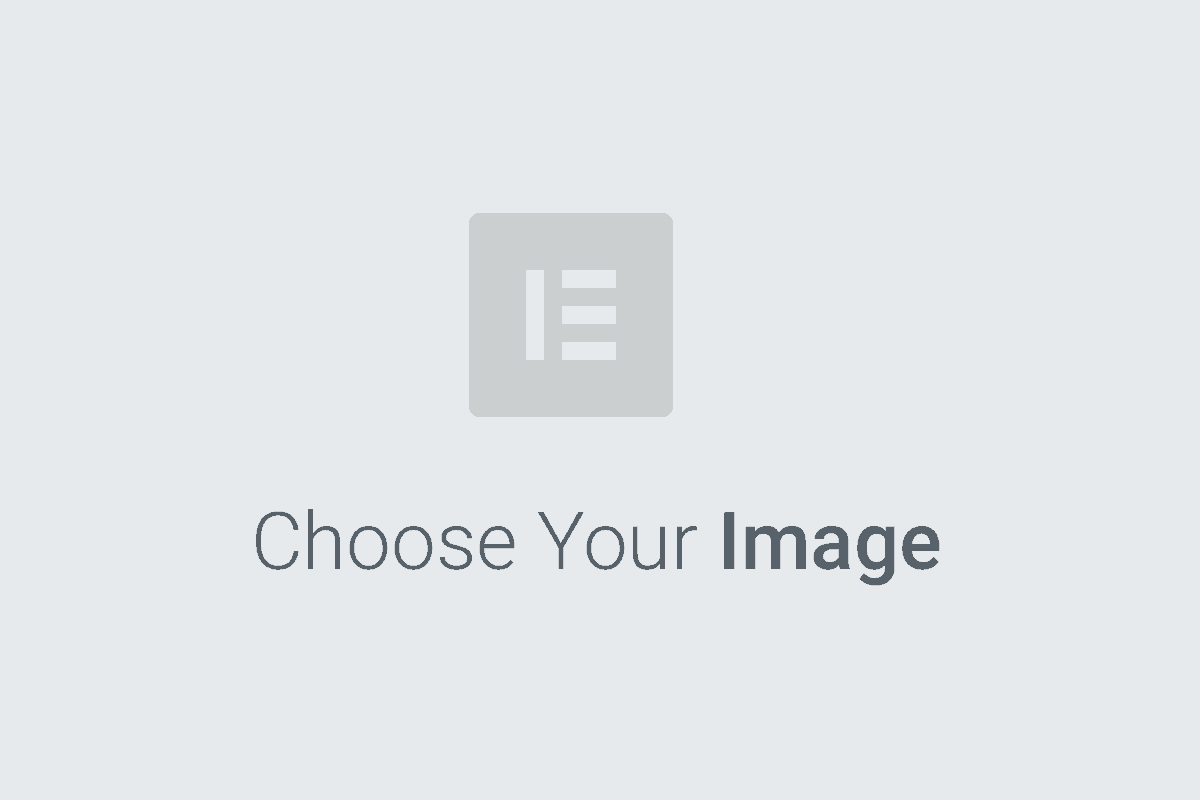
Lorsqu’un grand nombre d’ovules atteignent la maturité, le médecin les prélève par ponction des follicules sous anesthésie générale ou locale et sous contrôle échographique.
En règle générale, le prélèvement du sperme du partenaire s’effectue le même jour que la ponction des follicules. Le sperme peut également provenir d’un échantillon congelé ou d’un don. En laboratoire, les techniciens fécondent les ovules ponctionnés avec les spermatozoïdes. Ils cultivent ensuite les embryons ainsi créés in vitro, entre 2 et 5 jours, en les observant quotidiennement.
Par la suite, le médecin transfère un ou deux embryons de qualité dans l’utérus de la femme. Il est possible de congeler et conserver les embryons de qualité non utilisés pour un éventuel traitement ultérieur.
-
stimulation
-
La stimulation
Sur la base des différents taux hormonaux de la femme (analyses pouvant être prescrites par le gynécologue habituel), le médecin de la Clinique établit un protocole de stimulation adapté.
La stimulation ovarienne dure de 10 à 14 jours. Pendant cette période, le personnel médical administre quotidiennement des gonadotrophines par injection sous-cutanée. Il est essentiel de contrôler étroitement la phase de stimulation par échographie. En général, l’objectif est d’obtenir de 6 à 12 follicules.
-
ponction
-
La ponction des ovules
Les ovules sont prélevés par aspiration des follicules, sous anesthésie générale légère. Cette intervention dure environ vingt minutes.
-
fécondation
-
La fécondation des ovules
Deux méthodes de fécondation existent : la fécondation in vitro classique et la fécondation par injection des spermatozoïdes dans l’ovule (ICSI).
Au préalable, les spermatozoïdes sont sélectionnés, au besoin, par PICSI, IMSI et MACS, ou d’autres méthodes développées en interne par la clinique.
-
culture
-
La culture des embryons
Les embryons créés lors de la fécondation sont cultivés pendant 2 à 6 jours dans des incubateurs spéciaux, conçus pour « imiter » au mieux l’environnement naturel du corps de la femme. Leur développement est suivi méticuleusement.
La culture prolongée des embryons jusqu’à 5 ou 6 jours et leur observation déterminent ceux qui auront le plus de chance de résulter en une grossesse. Cette technique permet d’éviter, dans certains cas, le transfert de plusieurs embryons. Ainsi, elle diminue le nombre de grossesses gémellaires risquées pour la femme.
-
transfert
-
Le transfert embryonnaire
Le transfert embryonnaire est sans douleur et ne dure que quelques minutes (pas d’anesthésie). Selon l’âge, la problématique et le désir du couple, un ou deux embryons sont introduits dans l’utérus de la femme sous contrôle échographique.
-
conservation
-
La cryoconservation
Les embryons créés et non utilisés lors du premier transfert peuvent être conservés dans de l’azote liquide à moins 196°C. Ces embryons pourront être cryoconservés pour un éventuel transfert ultérieur. Le taux de réussite de la congélation / décongélation dépend du laboratoire et des ses équipement.
La stimulation
Sur la base des différents taux hormonaux de la femme (analyses pouvant être prescrites par le gynécologue habituel), le médecin de la Clinique établit un protocole de stimulation adapté.
La stimulation ovarienne dure de 10 à 14 jours. Pendant cette période, le personnel médical administre quotidiennement des gonadotrophines par injection sous-cutanée. Il est essentiel de contrôler étroitement la phase de stimulation par échographie. En général, l’objectif est d’obtenir de 6 à 12 follicules.
La ponction des ovules
Les ovules sont prélevés par aspiration des follicules, sous anesthésie générale légère. Cette intervention dure environ vingt minutes.
La fécondation des ovules
Deux méthodes de fécondation existent : la fécondation in vitro classique et la fécondation par injection des spermatozoïdes dans l’ovule (ICSI).
Au préalable, les spermatozoïdes sont sélectionnés, au besoin, par PICSI, IMSI et MACS, ou d’autres méthodes développées en interne par la clinique.
La culture des embryons
Les embryons créés lors de la fécondation sont cultivés pendant 2 à 6 jours dans des incubateurs spéciaux, conçus pour « imiter » au mieux l’environnement naturel du corps de la femme. Leur développement est suivi méticuleusement.
La culture prolongée des embryons jusqu’à 5 ou 6 jours et leur observation déterminent ceux qui auront le plus de chance de résulter en une grossesse. Cette technique permet d’éviter, dans certains cas, le transfert de plusieurs embryons. Ainsi, elle diminue le nombre de grossesses gémellaires risquées pour la femme.
Le transfert embryonnaire
Le transfert embryonnaire est sans douleur et ne dure que quelques minutes (pas d’anesthésie). Selon l’âge, la problématique et le désir du couple, un ou deux embryons sont introduits dans l’utérus de la femme sous contrôle échographique.
La cryoconservation
Les embryons créés et non utilisés lors du premier transfert peuvent être conservés dans de l’azote liquide à moins 196°C. Ces embryons pourront être cryoconservés pour un éventuel transfert ultérieur. Le taux de réussite de la congélation / décongélation dépend du laboratoire et des ses équipement.
